Fragments from the book Poirier P.J. Traité d'anatomie
humaine. T.1 (1892). The selected passages summarized the basic information
about ligamentum capitis femoris (LCF) obtained by the end of the 19th century.
The author provides data on the strength of LCF obtained in cooperation with
Paul Gilis.
The text is prepared for machine translation using a service built into the blog from Google or your web browser. In some cases, we have added links to quotations about LCF available on our resource, as well as to publications posted on the Internet.
Quote pp. 653-666
§ II. — ARTICULATION
COXO-FÉMORALE.
C'est le type
des énarthroses.
SURFACES
ARTICULAIRES. — Tête fémorale. — La tète du fémur, arrondie, représente à peu pi'ès les deux tiers d'une
sphère (A). Sa surface articulaire, lisse, limitée p:ir une ligne sinueuse, se prolonge
en avant et en arrière sur le col fémoral. L'angle qu'elle forme sur la face postérieure
du col est arrondi ; l'angle ou prolongement qui s'avance sur la face antérieure
est variable ; il répond à cette empreinte osseuse à laquelle j'ai donné le nom
d'empreinte iliaque, parce qu'elle résulte du contact de l'avancée osseuse qui supporte
l'épine iliaque antéro 'inférieure avec cette partie de la face antérieure du col,
dans la flexion de la cuisse sur le bassin (V. fig. 549 et Ostéologie, p. 210 et
rem. C, p. 220).
Le cartilage
d'encroûtement qui revêt la (ète fémorale s'avance plus ou moins sur cette empreinl.
Il alteint sun maximum d'épaisseur à la partie tie supérieure de la tète.
Au-dessous et en arrière de sa partie la plus saillante, la tète esl creusée d'une fossette ovalaire ; cetle fossette qui donne insertion dans sa partie antéro-supèrieure au ligament rond est écliancrèe dans sa partie postéro-inférieure, plus large et moins profonde par le frottement de ce ligament (H).
Cavité cotyloide. — A peu près hémisphérique, la cavité
colyloïde est limitée sur l'os sec par un bord saillant, presque tranrhant, le sourcil
cotyloïdien, vec ses deux dépressions, l'ilio-pubienne et l'ilio-ischiatique, et
sa large échancrure ischio-pubienne (V. Ostéologie, p. 186). — A l'intérieur de
cette cavilé, un croissant articulaire, lisse, dont les extrémités ou cornes répondent
aux liords de l'échancrure, entoure en fer à cheval l'arriére-fond, excavé à ti'ois
ou quatre millimètres au-dessous du niveau du croissant articulaire. Cet arrière-fond,
loge iliaque du ligamott rond, présente |»ar places des orifices vasculaires plus
ou moins nombreux.
A l'élat frais,
le fer à citerai articidaire est revêtu d'une couche de cartilage hyalin dont l'épaisseur
augmente de la partie centrale vers la partie pèriphérique et atteint son maximum
vers le pôle supérieur de la cavité. Sur ce cartilage on voit parfois (V. fig. 541),
en continuité avec les dépressions du sourcil cotyloïdien, deux étranglements ou
deux traînées grisâtres, vestiges de la réunion des trois os qui ont contribué à
la formation de la cavité (ilion, ischion, pubis).
L'arrière-fond
est tapissé par un périoste mince, assez facile à détacher et l'ccouvert d'une masse
graisseuse rougeàtre, presque tluide.
Bourrelet
cotyloïdien. — Un bourrelet fibro-cartilagineux prismatique et triangulaire, le bourrelet cotyloidien, s'applique
au sourcil cotyloïdien qu'il surélève, augmentant ainsi de toute sa hauteur la profondeur
de la cavilé. Ce bourrelet, en forme d'anneau prismatique, répond et s'insère par
l'une de ses faces, dite face adhérente ou base, au pourtour du sourcil ; par sa
face interne, concave et unie, il continue la surface articulaire delà cavité cotyloïde,
et entre ainsi en contact avec la tête fémorale ; par sa face externe, il donne
insertion à la capsule articulaire.
Au niveau des
dépressions ilio-pubienne et ilio-ischiatique, le bourrelet reste en général séparé
de l'os par un sillon plus ou moins profond. J'ai vu ce sillon s'étendre à toute
la moitié supérieure du bourrelet qui apparaissait détachée et flottante.
Au niveau de récliancrure ischio-pubienne, le bourrelet s'insère aux deux extrémités de l'échancrure par deux trousseaux larges et épais, immédiatement en dehors des cornes du croissant articulaire ; quelques fibres, arciformes, allant d'une corne à l'autre, achèvent le pont fibreux qui transforme l'échancrure en trou, et qui porte le nom de ligament transverse de l'acetabuhim.
 |
| Fig. 541. — Cavité cotyloïde, vuo de face, avec le bourrelet cotyloïdien entouré par la capsule articulaire. |
Le bourrelet cotyloïdien est formé de faisceaux fibreux qui s'insèrent très obliquement sur tout le pourtour cotyloïdien, et s'incurvent pour décrire un trajet plus ou moins circulaire. A ces fibres, qui forment la partie principale du bourrelet, s'ajoutent des fibres annulaires; on rencontre surtout ces dernières vers la face articulaire du bourrelet (C).
La hauteur du
bourrelet cotyloïdien varie de 5 à 10 millimètres ; inégaie sur les divers points
du pourtour, elle est toujours plus grande en arrière et en haut qu'en avant et
en bas.
Il faut remarquer
que le tissu fibro-cartilaigineux du bourrelet envahit la surface articulaire cotyloïdienne
dans sa partie supérieure. Cet envahissement, analogue à celui que nous avons constalé
dans le tiers inférieur de la cavité glénoïde de l'omoplate, n'est pas constant,
bien qu'il se présente dans la majorité des cas. Sur l'os sec, les traces de cet
envahissement sont indiquées par une différence d'aspect et de niveau de la région
envahie.
J'ai vu sur un grand nombre de pièces le tissu fibro-cartilagineux s'avancer jusqu'à l'arrièrefond et même s'unir à celui-ci par l'intermédiaire d'une tache arrondie, au niveau de laquelle le revêtement n'est plus cartilagineux mais fibrocartilagineux. J'ai fait représenter (V. fig. 542) cette disposition qui n'a point encore été signalée bien qu'elle soit assez fréquente.
 |
| Fig. 542. – Cavité cotyloïde, vue de face, avec son revetement cartilagineux. L'arrière-fond est recouvert par la synoviale soulevée par le ligament rond. |
MOYENS D'UNION. — Le fémur et l'os iliaque sont unis
par une capsule fibreuse, présentant des faisceaux de renforcement; cette capsule
forme un manchon épais ou mieux un cone fibreux tronqué, à sommet cotyloïdien. Accessoirement
les deux os sont encore unis par un ligament, dit ligament rond ou interarticulaire.
Capsule. — Du côté de l'os iliaque, la capsule
s'insère au pourtour osseux du sourcil cotyloïdien et à la face externe du bourrelet,
dont elle laisse libre le bord tranchant, surtout à la partie postérieure de l'articulation.
Au niveau de l'échancrure iscliio-pubienne la capsule s'insère à la face externe
et sur le bord libre du bourrelet; elle laisse ainsi libre le trou ostéo-fibreux
qui donne accès dans l'arrière-fond de la cavité cotyloïde.
Du pourtour
de la cavité articulaire, la capsule fibreuse se dirige en bas et en dehors pour
aller prendre son insertion inférieure autour du col fémoral. En avant, elle vient
s'insérer à l'angle antéro-supérieur du grand trochanter et de là à toute l'étendue
de cette large ligne rugueuse, dite à tort ligne intertrochantérienne antérieure
, car elle n'atteint pasle petit trochanter dont elle reste toujours séparée par
une dépression, la fossette prétrochantinienne (D).
De l'extrémité
inférieure de cette ligne, l'insertion capsulaire se recourbe à angle aigu et remonte
suivant une ligne oblique qui passe en avant du petit trochanter pour gagner la
face postérieure du col, qu'elle suit parallèlement à la ligne intertrochantérienne
postérieure, mais à un travers de doigt en dedans de celle-ci, pour regagner l'angle
aniéro-supérieur du grand trochanter. — C'est une erreur bien répandue de dire que
la capsule ne s'insère pas à la face postérieure du col, mais qu'elle s'y termine
par un bord libre formant demi-anneau sur la surface postérieure du col auquel elle
n'adbère que par l'intermédiaire de la synoviale. En effet, l'insertion à la face
postérieure du col est réelle et constante; assez faible d'ordinaire, pour que le
scalpel, suivant le bord très net de la zone orbiculaire, la détache facilement,
elle est parfois assez forte pour laisser sur l'os une empreinte linéaire.
Comme on le
voit, l'insertion fémorale de la capsule se fait ou paraît se faire à une assez
grande distance du revêtement cartilagineux de la tète; cependant on peut voir que
ses fibres profondes se réfléchissent sur le col et remontent sur lui en certains
points jusqu'au pourtour de la surface articulaire. Ces faisceaux récurrents (V.
fig. 543) soulèvent la synoviale, formant ainsi des replis, visibles surtout le
long des bords du col ; les anciens anatomistes ont décrit ces replis sous les noms
de plica, relinacula, frenulacapsulae. C'est sur le bord inférieur du col que l'on
rencontre les principaux de ces replis; l'un d'eux, principal et constant, mérite
particulièrement l'attention; j'en parlerai plus loin à propos du ligament rond.
Dans l'ensemble
, la capsule, remarquable par sa force et son épaisseur, représente un cône à base
cotyloïdienne , dont le sommet tronqué enserre le col fémoral. Une disposition inverse
se présente à l'épaule où la capsule forme un cone tronqué à base humérale, à sommet
glénoïdien. Remarquons encore que la capsule fibreuse est moins lâcheàla hanche
qu'à l'épaule ; cependant il faut se garder d"affirmer,comme on le fait communément,
que cette capsule, très serrée, maintient solidement la tête du fémur dans la cavité
cotyloïde. Cela n'est vrai que dans l'extension extrême, qui tord et par conséquent
raccourcit la capsule ; dans la flexion moyenne, la capsule coxo-fémorale est assez
lâche pour permettre un écart d'un à deux centimètres entre les surfaces articulaires;
à la hanche comme à l'épaule, la pression atmosphérique et la tonicité musculaire
interviennent pour maintenir le contact (E).
 |
| Fig. 543. — Extrémité supérieure du fémur avec sa collerette capsulaire, et le repli pectinéo-fovéal. |
Envisagée au point de vue de sa conslilulion, la capsule comprend un plan profond, mince, de fibres annulaires ou très obliques, et un plan superficiel beaucoup plus important, composé de faisceaux longitudinaux allant de l'os iliaque au fémur; les faisceaux longiturlinaux sont décrits sous le nom de ligaments ou faisceaux de renforcement ; la couche profonde fornie la zone orbiculaire.
Ligaments
ou faisceaux de renforcement longitudinaux. — Ils se détachent des trois parties de l'os iliaque
et portent par suite les noms d' ilio-fémoral, ischio- fémoral et pubo-fémoral.
Ligament ilio-fémoral ou ligament de Bertin. — C'est le plus fort des ligaments de la hanche; il revêt la forme d'un éventail tibreux dont le sommet se fixe au-dessous de l'épine iliaque antéro inférienre, et dont la base élargie s'attache à la ligne dite intertrochantérienne aniérieure (F).
 |
| Fig. 544 — Articulation coxo-femorale, vue antérieure. |
Dans cet éventail fibreux, il faut distinguer deux faisceaux :
1° Le faisceau supérieur, qui se porte en dehors, presque parallèlement à l'axe du col, et va s'attacher à un tubercule, situé en avant du grand trochanter, immédiatement en dedans de l'empreinte du petit fessier; c'est le faisceau ilio-prétrochantérien, le plus court, le plus fort, le plus épais des ligaments de la hanche. La largeur de son insertion iliaque au-dessous et en arrière de l'épine iliaque antéro-inférieure, au-dessus et au-dessous de la gouttière osseuse qui loge le tendon réfléchi du droit antérieur, la saillie toujours très accentuée du tubercule prétrochantérien, témoignent de la force de ce faisceau dont l'épaisseur atteint souvent et parfois dépasse un centimètre (de 7 à 14 mm.)
 |
| Fig. 545. — Articulation coxo-fémorale, vue d'en bas. Le fémur est fléchi à angle droit sur l'os iliaque. |
L'insertion
iliaque de ce ligament s'étend presque toujours à 2 ou 3 centimètres en arrière
sur le contour supérieur du sourcil cotyloïdien, où elle englobe le tendon réfléchi
du droit antérieur.
Ce faisceau
supérieur, ilio-prétrochantérien, du ligament ilio-fémoral limite l'adduction et
la rotation en dehors ; il contribue à limiter l'extension de la cuisse.
Souvent ce faisceau
supérieur reçoit des expansions tendineuses, soit du petit fessier, soit du droitantérieur
; parfois l'expansion tendineuse du droit antérieur va jusqu'au fémur et celle du
p;'tit fessier jusqu'au grand trochanter; je ne vois pas qu'il y ait lieu de décrire
connue ligaments spéciaux ces expansions qui ne sont point d'ailleurs constantes.
2° Le faisceau inférieur du ligament ilio-fémoral (lig. anterius de Welcker, superius de Henke?)
descend presque verticalement de l'insertion iliaque vers le tubercule inférieur
de la ligne dite intertrochantérieune antérieure; comme ce tubercule est situé
en avant du petit trochanter dont il est séparé par une fossette, j'appelle ce faisceau
ilio-pretrochantinien. — Plus long que le faisceau supérieur, il est moins épais;
son épaisseur ne dépasse guère un demi-centimètre; — il limite l'extension.
 |
| Fig. 546. — Articulation coxo-fémorale, vue posterieure. |
Entre ces deux faisceaux de renforcement, l'éventail ilio-fémoral, aminci, montre quelques faisceaux apparlenant au système dos fibres circulaires.
Ligament pubo-fémoral.
— II naît de la portion pubienne du rebord cotyloïdien, de l'éminence ilio-pectinée,
et du bord inférieur de la branche horizontale du pubis; de là, il se dirige en
bas, en dehors et un peu en arrière, pour aller s'attacher dans la partie antérieure
de la fossette prétrochantinienne ; il est done pubo-prétrochantinien. — Il se tend
dans l'abduction.
Il forme avec
le faisceau vertical, ilio-prétrochantinien, du ligament ilio-fémoral, un V à pointe
trochantinienno, ouvert en haut et en dedans. Welcker remarque que le ligament pubo-fémoral
forme, avec les deux faisceaux de l'iliofémoral, un N.
Le ligament
pubo-fémoral, recouvert en partie par le muscle pectiné, est renforcé par des faisceaux
de l'aponévrose de ce muscle, et par d'autres faisceaux intermédiaires au pectiné
et au psoas-iliaque. Son insertion se prolonge plus ou moins sur le bord inférieur
de la branche horizontale du pubis, parfois jusqu'à l'épine pubienne; son bord tranchant,
formé de feuillets superposés et séparés par des pelotons adipeux, donne insertion
au tendon du muscle obturateur externe.
Entre les ligaments
ilio et pubo-fémoral, la capsule, fort mince, est représentée par quelques faisceaux
qui se détachent de la partie du sourcil cotyloïdien placée en j'egard do l'éminence
ilio-pectinée. Là, la capsule répond au muscle psoas-iliaque : le fi'ottement du
tendon de ce muscle sur la capsule soulevée par la tète fémorale a déterminé la
formation d'une large bourse séreuse qui se prolonge jusque vers l'insertion trochantinienne
du psoas. Chez certains sujets l'amincissement de la capsule peut aller jusqu'à
la perforation ; alors la synoviale articulaire et la séreuse musculaire communiquent
par un orifice arrondi plus ou moins grand ; j'ai recherché sur une centaine de
sujets cette communication; je l'ai rarement rencontrée chez les enfants au dessous
de 10 ans; elle devient d'autant plus fréquente qu'on la cherche chez des sujets
plus avancés en âge; à mon avis, elle résulte de l'usure de la capsule par la répétition
des frottements.
Ligament ischio-fémoral.
— De la partie du sourcil cotyloïdien qui répond à l'ischion et particulièrement
de la gouttière sous-cotyloïdieane se détachent des faisceaux fibreux qui se portent
très obliquement (presque horizontalement) en dehors, en haut et en avant, par-dessus
le bord supérieur du col fémoral et vont s'attacher an-dessus et en avant de la
fossette digitale, immédiatement en avant de l'insertion commune de l'obturateur
interne et des deux jumeaux. Ce ligament, large à sa base ischienne, se rétrécit
progressivement, et prend ainsi une forme triangulaire. — En raison de ce fait qu'il
croise et contourne le bord supérieur du col fémoral, sur lequel il s'applitjue
comme une bretelle sur une épaule, ce ligament peut être dit ischio-sus-cervical.
Quelques-uns
des faisceaux du ligament ischio-fémoral, les inférieurs surtout, se terminent dans
la couche des fibres circulaires (V. fig. 546) ; ces faisceaux sont décrits sous
le nom d'ischio-zonulaires ou capsulaires.
Ces faisceaux
ischio-zonulaires, plus ou moins nombreux, sont toujours beaucoup moins forts que
les faisceaux qui se rendent au fémur, par-dessus le col de celui-ci ; Henle a certainement
exagéré en décrivant le ligament ischio-fémoral comme ischio-capsulaire (G).
Le ligament
ischio-fémoral, en rappot immédiat avec le tendon de l'obturateur interne, limite
la rotation en dedans du fémur.
Entre le bord
inférieur du ligament ischio-fémoral el le ligament pubo-fémoral, la capsule très
amincie montre ses faisceaux circulaires. Cependant quelques faisceaux
longitudinaux, sans importance, venant des membranes obturatrices, viennent se perdre
sur cette partie de la capsule que recouvre l'obturateur externe (V. fig. 545.)
Je crois devoir
répéter, en finissant cette courte description des renforcements ou ligaments
longitudinaux, que, dans l'extension qui est la position normale de la cuisse, tous
ces ligaments légèrement tordus et tendus (V. fig. 547), vont de l'os i1iaque au
fémur en décrivant sur le col un trajet en spirale, et apliquent l'une contre l'autre
les surfaces articulaires d'autant plus que l'extension est plus grande ; tandis
que, dans une flexion modérée, ils se relâchent, se redressent (V. fig. 548), deviennent
presque parallèles et permettent l'écartement des surfaces articulaires.
 |
| Fig. 547. — Extension. Fig. 548. — Flexion. Schémas des ligaments de l'articulation coxo-fémorale, vue postérieure (imités de Welcker). |
La partie amincie
de la capsule, comprise entre les ligaments pubo et ischiofémoral, est presque uniquement
constituée par les fibres annulaires (V. fig. 545) ; quand la cuisse est en flexion,
ces fibres unissent transversalement les deux ligaments devenus parallèles; dans
l'extension, elles s'appliquent à la fdce postérieure du col. Là, le bord de la
zone orbiculaire est nettement visible, n'étant recouvert que par les fibres capsulaires,
clairsemées, qui vont s'insérer à la face postérieure du col (I).
Ligament
dit rond. — Le ligament
interarticulaire si improprement appelé ligament rond, est en réalité un ligament
triangulaire qui s'attache par sa base à l'échancrure cotyloïdienne et va se fixer
par son sommet dans la fossette de la tôte fémorale.
Ce n'est point
sous cette forme de lame fibreuse triangulaire que l'on décrit d'ordinaire ce ligament,
cylindre creux pour quelques anatomistes, cône fibreux ou prisme pour d'autres,
frange synoviale pour Henle.
Ces divergences
s'expliquent p ir ce fait qu'en pénétrant dans l'articulation le ligament rond soulève
la synoviale en une sorte de tente dont la base s'attache au pourtour de l'arrière-fond
de la cavité cotyloïde ; mais si l'on a soin, par une dissection, que la pince procédant
par simple arrachement suffit à accomplir, de détacher la graisse et le repli synovial,
on réduit vite le ligament à ce qu'il est réellement : une épaisse lame triangulaire
qui se détache de la fossette fémorale, descend en s'enroulant et s'élargissant
sur la tète fémorale pour gagner l'échancrure cotyloïdionne où elle se fixe de la
façon que je vais dire.
A l'état normal,
quand les surfaces articulaires sont en conlacl, le ligament rond occupe l'arrière-fond
de la cavité cotyloïde, arrière-fond qui n'a d'autre raison d'être que l'existence
du ligament.
Parti de son
insertion à la portion antéro-supérieure de la fossette fémorale, le ligament, d'abord
arrondi et épais, devient une lame triangulaire : les bords de cette lame, racines
ou branches du ligament rond, vont se fixer aux deux extrémités ou cornes qui limitent
l'échancrure cotyloïdienne, en dehors de l'artioculation.
La branche supérieure
ou pubienne, assez grêle, se dirige, obliquemenl en bas et en avant et se fixe à
la corne supérieure de l'échancrure, immédiatement en deliurs du cartilage ;
la branche inferieure ou, ischienne, lame libreuse trés forte, sort de l'arliculalion
et vient se li.xer sur la face externe de l'ischion (V. fig. 549). La portion moyenne
du ligament triangulaire plus mince s'attache à cette portion du bourrelet qui forme
le pont acétabulaire.
Telle est l'insertion
péri ou extra-articulaire du ligament rond. Je ne saurais consentir avec quebiues
ailleurs à lui décrire une insertion au pourtour de l'arriére-fond de la cavité
cotyloïde ; il n'y a là quc quelues travées fibreuses, soulevant un repli synovial,
que la pince arrache facilement.
La force du
ligament rond est des plus variables : dans quelques cas rares c'est une simple
bride fibreuse doublée d'une frange synoviale que la moindre traction peut arracher.
D'ordinaire c'est un ligament assez fort pour résister à des tractions de 30 à 50
kilogrammes ; les deux réunis peuvent supporter une traclion dans l'axe variant
de 60 à 70 kilogrammes (expériences faites avec Gilis [Gilis Jean-Louis-Paul-Marie Antoine]).
 |
| Fig. 550. — Figure scliématique destinée à montrer les deux racines du ligament rond. |
La struclurc
du ligament rond, ainsi réduit à ce qu'il est réellement, ne diffère en rien de
celle des autres ligaments articulaires.
Dans la frange
synoviale qui double sa face interne, frange que l'on peut comparer au ligament
adipeux de l'articulation du genou, on trouve de gros vaisseaux en continuité ou
non avec ceux de la tète fémorale ; le ligament proprement dit contient des vaisseaux
comme tous les ligaments et ces vaisseaux sont en continuité avec ceuxde l'os au
point où se fait l'insertion ligamenteuse : il n'y a là rien de particulier au ligament
rond.
Róle du ligament rond.
— Le mode d'action du ligament rond a été bien différemment apprécié. Considéré
autrefois comme un agent mécanique limitant le mouvement d'adduction, ou comme suspenseur
du tronc au fémur (Gerdy), le ligament rond devint plus tard avec Henle, Cruveilhier,
Luschka, Sappey, etc , « une sorte de canal fibreux ayant pour usage principal de
protéger les vaisseaux qui se portent à la tète du fémur. » — Los travaux modernes
nous ont ramené à une conception plus juste du role et de la signification de ce
ligament.
On ne saurait
nier toutefois que des vaisseaux gagnent la tête du fémur par le ligament rond.
A l'assertion de Hyrtl disant (Top. Anat., II, p. 121) que les injections fines
lui ont démontre que les vaisseaux se recourbaient en anse près de l'insertion fémorale
du ligament, on peut opposer les injections mieux réussies de Luschka (Anat. des
Menschen, III, p. 364) et de Sappey ; ces auteurs ont vu les vaisseaux pénétrer
dans la tète fémorale.
L'existence
de ces anastomoses, d'ailleurs inconstantes, puisqu'elles manquent dans un tiers
des cas environ, n'est point sulfisantc pour nous convaincre que le ligament rond
est « un porte-vaisseau ». La dissection nous a montré que c'était un ligament semblable
en tout aux autres ligaments articulaires : c'est donc dans les phénomènes mécaniques
que nous devons chercher sa raison d'être.
L'opinion de
Welcker qui fait du ligament rond une sorte de balai ou de pinceau destiné à étendre
la synovie sur les surfaces articulaires, est à rejeter. Je no puis accepter davantage
l'opinion de Tillaux qui le considère comme un ligament d'arrét « s'opposant à
ce que la téte fémorale vienne presser et défoncer le fond de la cavité cotyloïde
dans une chute sur le grand trochanter ». Il suffît de réfléchir que la sphère fémorale
logée dans la demi-sphère colyloïdienne de même rayon ne peut en aucun cas, même
en l'absence du ligament, entrer en contact avec la partie excavée de cette demi-sphère
avant d'avoir fait éclater celle-ci. La figure 230 de l'excellent traité de Tillaux
montre à l'évidence que le contact de la tête avec l'arrièrc-fond n'est possible
qu'après éclatement de la cavité.
C'est vers l'opinion
ancienne d'un ligament rond se tendant au cours de certains mouvements que nous
ramènent les travaux récents ; les expériences de Morris, répétées par Gilis et
par moi, expériences dans lesquelles une large fonestration do la cavité cotyloïde
permet de vérifier la tension du ligament rond sous-tendu par un fil dans les divers
mouvenaenls de la hanche, ont mis hors de doute les faits suivants :
l° Le ligament
rond, simplement allongé dans la station verticale, se tend lors de la flexion
de la cuisse sur le bassin.
2° Dans la flexion, et seulement dans cette position, il contribue à limiter les mouvements d'adduction et de rotation en dehors.
J'ajouterai
une restriction capitale : cette action mécanique est faible; en effet je me suis
assuré que la section du ligament rond ne modifie ni la forme ni l'étndue des mouvements
de la hanche. — D'ailleurs l'extrême variabilité dans le développement et la force
de ce ligament, son absence congénitale parfois observée (Palletia, Moser) tendent
à faire croire que le ligament rond ilf l'homme est en train de s'atrophier et de
disparaitre.
A l'appui de
cette remarque, l'étude comparative du ligament rond chiez les vertébrés nous montre
ce ligament très développé et en partie musculaire (diez un grand nombre de mammifères
et d'oiseaux. Les travaux de Welcker, de Sutton, de Moser et de beaucoup d'autres
prouvent que le ligament rond doit être considéré comme une partie de la capsule
invaginée dans l'articulation, modification produite par le changement d'attitude.
Moser (Uber das Ligamentum teres des Huftgelenkes, Anat. Anz. 1892, n° 3, p. 82),
montre, en conformité avec cette opinion, que le ligament rond de l'homme présente
au cours de l'évolution embryonnaire les états divers sous lesquels on le retrouve
dans la série : capsulaire d'abord, il proémine sur la face articulaire de la capsule,
et reste pendant un cerlain temps sessile avant de s'isoler comme il se montre chez
l'adulte.
Chez l'adulte
mémie, on retrouve des traces de l'extériorité antérieure du ligament rond. Dans
un travail récent, Amantini (di una men nota ripiegatura synoviale dell' arliculazione
dell' anca ; Instituto anat. dell' Univ. di Perugia) rattache au ligament rond le
repli constant qui soulève la synoviale sur le bord inférieur du col ; il le montre
situé sur la ligne unissant la fossette fémorale au petit trochanter ; il considère
ce repli qu'il appelle repli pectinofovéal comme un vestige d'un muscle pubo-fémoral
que l'on retrouve chez certains animaux et dont le ligament rond représente le tendon
(V. fig. 543).
SYNOVIALE. — La synoviale, née du pourtour du bourrelet
colylo'fdien , revêt la face articulaii e de la capsule, se rélléchit au niveau
des insertions fémorales de celle-ci pour tapisser la parlie intra-articulaire du
col et vient se terminer au pourtour de la surface cartilagineuse de la tète fémorale.
A cette grande
synoviale il faut ajouter la leule synoviale que soulève le ligament rond. Le sommet
de cette tente entoure la partie fémorale du ligament rond et tapisse cette partie
de la fossette sur laquelle frotte le ligament dans les mouvements de la hanche;
la base de la tente s'insère au pourtour de l'arrière-fond. C'est cette synoviale
du ligament rond qui ferme le trou cotyloïdien par lequel on voit, après une injection
réussie, émerger quehjues bourgeonssynoviaux.Ces bourgeons sont au jeu d'un peloton
adipeuxque l'abduction chasse de l'arrière-fond et que l'adduction y fait rentrer.
Parmi les culs-de-sac
synoviaux, il faut signaler le bourrelet semi-annulaire que forme la synoviale débordant
les fibres zonulaires sur la face postérieure du col. Au niveau de ce bourrelet,
le mince feuillet synovial n'est doublé que par quelques fibres longitudinales ;
c'est invariablement en ce point que crève la synoviale quand l'injection est poussée
avec trop de force.
Au point de
sa réflexion de la capsule sur le col, la synoviale, soulevée par les fibres récurrentes
(replis) de la capsule, forme des logettes de dimensions variables. L'une d'elles
est constante et ronarquable par son étendue; elle s'enfonce sous ce repli capsulaire
qui suit le bord inférieur du col, repli pectinéo-fovéal d' Amantini.
Au niveau des
dépressions du sourcil cotylo'idien, la synoviale s'enfonce dans le sillon intermédiaire
au bourrelet et à la dépression ; j'ai vu assez souvent un gros cul-de-sac synovial
s'engager sous la partie supérieure décollée du bourrelet. A ces détails se rattache
la formalion de ces petits kystes ou ganglions synoviaux dont la présence n'est
poinl rare en cette arliculatioii ; j'en ai présenté des exemples à la Société anatomique.
Lorsqu'on injecte la synoviale, on constate que la cuisse se place en flexion, position qui répond au maximum de contenance de la cavité articulaire ; c'est la position des arthrites avec épanchenient, au moins à leur début.
 |
| Fig. 551. — Articulation coxo-fémorale, coupe frontale passant au niveau de la fossette du ligament rond. |
Sur des pièces
dont la synoviale a été injectée, on constate toujours un étranglement annulaire,
qui donne à la synoviale injectée la forme d'un sablier bas; cet étranglement, qui
répond aux fibres zonulaires, témoigne de la force de celles-ci.
J'ai déjà signalé la communication qui s'établit parfois entre la synoviale articulaire et la bourse séreuse du psoas.
Quote p. 667
Artères. — La fémorale profonde el l'iliaque
interne fournissent toutes les artères articulares lie la hanche.
Les deux artères
circonflexes, antérieure et postérieure, branches de la fémorale profonde, qui s'anastomosent
autour du col en formant une véritable arcade artérielle, donnent à l'articulation
do nombreuses brandies. — La circonflexe postérieure donne une branche qui pénètre
sous le ligament transverse et gagne le ligament rond. — La circonflexe antérieure
donne une branche qui perfore le ligament ilio-fémoral, vers sa partie moyenne.
Les autres artères articulaires sont fournies par l'obturatrice, la fessière et l'ischiatique, branches de l'iliaque interne. — Celle qui nait de l'obturatrice passe sous le ligament transverse de l'acetabulum, et se divise en nombreuses brandies dans le tissu adipeux qui tapisse l'arrière-fond de la cavité cotyloïde. — La fessière fournit quelques rameaux qui pénètrent la capsule après avoir traversé le petit fessier, près de son insertion trochantérienne. — Une branche de l'ischiatique donne quelques artèies articulaires au moment ou elle passe sous les jumeaux et l'obturateur interne.
Nerfs. — Les nerfs de l'articulalion coxo-femorale,
bien decrits dans Beaunis et Bouchard, ont été l'objet de deux travaux récents.
D'après Chandelux
(Lyon Médical, avril 1880, t. 51), la partie antérieure de la capsule est innervée
par im rameau de la branche musculo-cutanée interne du nerf crural, ce rameau
n'étant autre qu'une bifurcation de la branche qui va au pectiné; — la partie posterieure
est innervée, tantôt par un rameau qui se detache du premier nerf sacré, tantôt
par un rameau qui nait tout près de l'origine du petit nerf sciatique, tantôt par
un filet de la branche du muscle crural. Chandelux n'a jamais rencontré de filet
nerveux fourni par l'obturateur.
Pour R. Duzéa (Lyon Médical, mai 1886, t. 52), les choses sont plus complexes. — La piartie antérieure delà capsule reçoit ses nerfs du plexus lombaire : 1° directment par les braches articulaires et lombaires interne et externe; — 2° indirectement par un rameau de l'obturateur et un rameau du crural. — L'obturateur donne; encore une autre branche qui se rend, par l'échaneruro ischio-pubienne, dans le ligament rond. — La partie postérieure de la capsule est innervée par le nerf ischiatique ou par le grand nerf sciatique ; la branche du sciatique vient tantôt du trone même du nerf, tantôt du filet du muscle carré crural.
Quote pp. 669
Adduction. —
La tète fémorale glisse de bas en haut dans la cavité cotyloïde. Ce mouvement,
impossible dans l'extension normale, à cause du contact dos deux membres inférieurs,
reste d'ailleurs très limité quelle que soit la position donnée au fémur. Il est
arrêté par la tension du faisceau supérieur, ilio-prétrochantérien, du ligament
de Bertin suppléé, dans la flexion, par le ligament rond. — D'api'ès les Weber,
l'excursion du fémur de l'adduction il l'abduction serait de 90°. — L'axe antéro-postérieur
passe par le centre de la tête fémorale.
…
Varia. — A. — La tète fémorale n'est pas régulierement
hemisphi'rique ; dans la plupart des cas, son diamètre vertical l'emporte de 1 mm.
sur son diamètre transversal: plus rarement, c'est le diamètre transversal qui est
le plus grand. Ayant fait un grand nombre de mensurations, j'ai remarqué que, lorsque
le diamètre transversal l'emporte sur le vertical, la tête a été déformée, soit
par arthrite, soit par une cause fonctionnelle.
B. — I faut
distinguer dans la fossette du ligament rond: 1° la véritable fossette d'insertion;
— 2° une large échancruro creusée par les frottements du ligament. Cette dernière
loge l'extrémité fémorale du ligament rond quand les surfaces articulaires sont
en contact, comme l'arrière-fond de la cavité cotyloïde loge l'extrémité iliaque
de ce même liganient. Ainsi est rendu possible le contact parfait de la sphère pleine
et de la sphère creuse.
Le revêtement
cartilagineux manque dans toute la fossette du ligament rond, aussi bien dans la
partie qui répond à l'insertion que dans l'encoche produte par les frottements du
ligament; cette dernière partie est revêtue d'une couche cellulo-fibreuse avec de
rares cellules cartilagineuses.
A l'état sec, on trouve, sur la plupart des femurs, 3 sur 4 environ, au fond de la fossette, des orifices qui donnent passage à des veines.
External
links
Poirier
P.J. Traité d'anatomie humaine. Tome 1, Fascicule 2 / par MM. A. Charpy,... A.
Nicolas,... A. Prenant,... E. Jonnesco ; publié sous la direction de Paul
Poirier. Paris: L. Battaille et Cie, 1892. [gallica.bnf.fr]
Poirier
P.J. Traité d'anatomie humaine. Tome 1, DEUXIÈME ÉDITION / par MM. A.
Charpy,... A. Nicolas,... A. Prenant,... P. Jacoques,...; publié sous la
direction de Paul Poirier. Paris: Masson et cie, 1896. [archive.org]
Authors
& Affiliations
Paul Julien Poirier (1853-1907), was a French surgeon
and anatomist, professor of anatomy at the Faculty of Medicine of Paris. [wikipedia.org]
 |
| Paul Julien Poirier. Wood engraving by A. Norieux. Source: Wellcome Collection, wellcomecollection.org (CC0 – Public Domain, color correction) |
 |
| Professor Paul Poirier's Anatomy Lesson [French anatomist, 1853-1907] - Georges-Alexandre Chicotot [Doctor and painter, (1855-1937)] Source: Elisandre Crowley [facebook.com] (color correction). |
Gilis Jean-Louis-Paul-Marie Antoine (1857-1929) was a French anatomist, professor of anatomy at the Faculty of Medicine in Montpellier University. (see: Bonnel F, Lavabre-Bertrand T, Bonnel C. The teaching of anatomy in Montpellier University during VIII centuries (1220–2020). Surgical and Radiologic Anatomy. 2019;41(10)1119-1128. [otcfa.fr , ac-sciences-lettres-montpellier.fr]
 |
| Paul GILIS, Prof. d’Anatomie (1927). The author of the image is Boisson Alfred Jacques; source: Musée d'anatomie de Montpellier [ac-sciences-lettres-montpellier.fr , pop.culture.gouv.fr] (fragment, color correction) |
Keywords
ligamentum capitis femoris, ligamentum teres, ligament of head of femur, anatomy, role, significance, properties, experiment
NB! Fair practice / use: copied for the purposes of criticism, review, comment, research and private study in accordance with Copyright Laws of the US: 17 U.S.C. §107; Copyright Law of the EU: Dir. 2001/29/EC, art.5/3a,d; Copyright Law of the RU: ГК РФ ст.1274/1.1-2,7
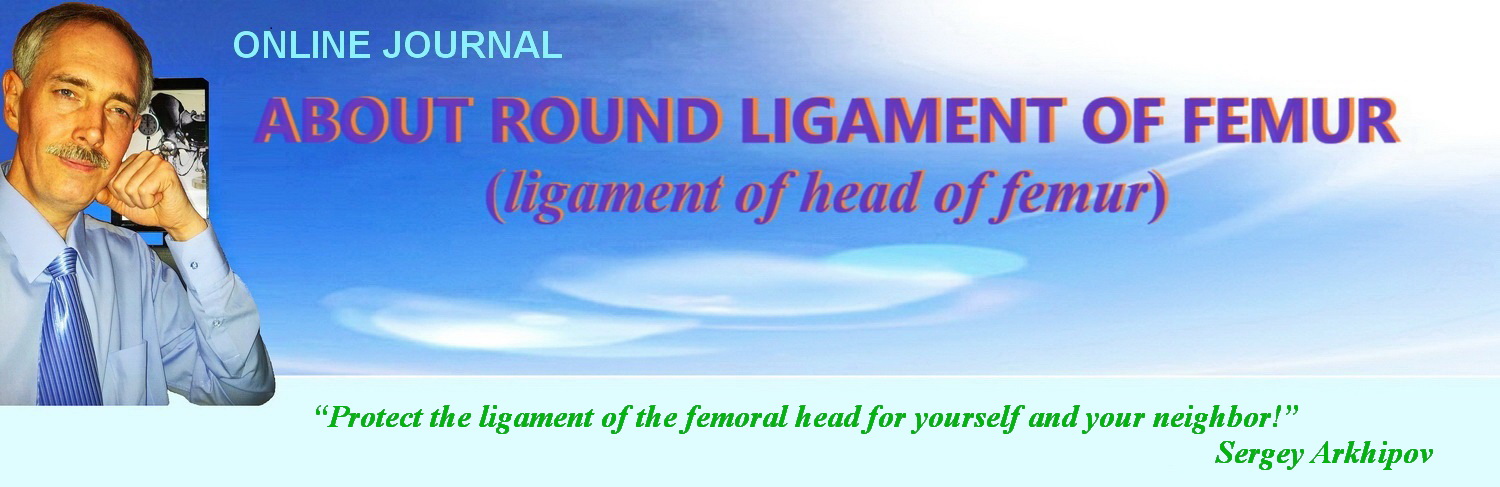



Comments
Post a Comment