Fragments of the book Richet A.
Traité pratique d' Anatomie medico-chirurgicale (1857) are devoted to the anatomy of the ligamentum capitis
femoris (LCF). The author believes that the vessels passing through the LCF are
sufficient to supply blood to the femoral head.
The text is prepared for machine translation using a service built into the blog from Google or your web browser. In some cases, we have added links to quotations about LCF available on our resource, as well as to publications posted on the Internet.
Quote pp. 922-923
Articulation
coxo-femorale. Cette articulation, qui appartient à la classe des énarthroses
dont elle représente le type, a été l'objet de travaux importants de la part
des physiologistes et des chirurgiens, et c'est aux frères Weber et à M.
Malgaigne, plutôt qu'aux anatomistes purs, qu'on doit d'avoir mis en lumière un
grand nombre des faits qui vont suivre et qui éclairent des questions
pathologiques avant eux restées insolubles. J'examinerai d'abord les surfaces
articulaires, puis leurs moyens d'union, et je terminerai par un coup d'œil
rapide jeté sur la physiologie de cette articulation.
Du côté de l'os coxal,
la surface articulaire est représentée par une cavité dite cotyloïde dont le
nom indique suffisamment la forme. Elle est située immédiatement au-dessous de
l'épine iliaque antérieure et de l'éminence iléo-pectinée dont la base prend
part à la formation du sourcil ou rebord cotyloïdien; elle occupe ainsi le
point de jonction des trois os qui primitivement forment l'os coxal,
c'est-à-dire de l'ilium, du pubis et de l'ischion, et réunit les deux portions
horizontale et verticale qui forment l'os de la hanche.
Sa cavité n'est pas
régulièrement arrondie; on peut lui distinguer deux portions, l'une qui occupe
son fond, et l'autre son pourtour.
La première présente
une surface rugueuse, irrégulière, percée de trous vasculaires nombreux, et
remplie à l'état frais par un paquet graisseux qui se continue avec le tissu
cellulaire extérieur au moyen de l'échancrure qui livre passage au ligament
rond. Située sur un plan plus élevé que l'autre, elle est fermée par une
lamelle osseuse transparente, et même si mince que chez quelques sujets elle
fléchit sous le doigt; elle répond à cette portion de la paroi interne du
bassin, intermédiaire au trou obturateur et aux échancrures sciatiques.
L'autre portion règne
tout autour du cotyle, et n'est interrompue qu'au niveau de l'échancrure déjà
signalée où elle est interrompue et se termine par deux bourrelets saillants.
Elle est lisse et revêtue de cartilage, sans trace de trous vasculaires,
séparée de la première par un bord sinueux, irrégulier, plus saillant aux deux
extrémités de la demi-'une qu'il représente qu'à son centre, et repose sur une
masse osseuse épaisse et compacte, désignée sous le nom de sourcil cotyloïdien.
Ce sourcil, sur lequel je reviendrai, constitue réellement la partie la plus
résistante de l'os coxal.
Il résulte de cette
disposition que la tête du fémur s'articule uniquement avec la portion
semi-circulaire de l'acetabulum encroûtée de cartilage et située sur un plan
plus inférieur, tandis que le fond même de la cavité ne contracte avec elle
qu'un contact médiat et par l'intermédiaire de la couche adipeuse précédemment
signalée. C'est ce dont il est facile de s'assurer sur le cadavre, lorsque
après avoir désarticulé le fémur et enlevé le peloton graisseux qui occupe le
fond du cotyle, on rassemble de nouveau les surfaces articulaires; en regardant
par l'échancrure, on voit qu'il reste entre la tête et la partie la plus
reculée de la cavité un espace de quelques millimètres qu'on ne parvient jamais
à faire disparaître, quelque fortes que soient les pressions qu'on exerce, soit
latéralement sur le grand trochanter, soit de bas en haut sur l'extrémité
inférieure de l'os.
La cavité cotyloïde
présente donc deux parties bien distinctes: une inférieure, encroûtée de
cartilage, dans laquelle se meut la tête du fémur et à laquelle le nom d'articulaire
conviendrait plus spécialement; une supérieure, occupant un plan plus élevé,
isolée de la première par de la graisse et qu'on pourrait pour cette raison
nommer extra-articulaire.
Cette disposition,
jointe à la dépression qu'on observe sur le point de la tête fémorale qui
correspond à la portion extra-articulaire de la cavité, dépression occupée par
le ligament rond, explique comment, malgré sa faiblesse, la lame osseuse qui
forme le fond du cotyle échappe aux violences capables de fracturer le col
fémoral ou le sourcil cotyloïdien; on comprendrait difficilement, si la tête du
fémur portait directement sur elle comme elle porte sur le pourtour de la
cavité, comment elle ne serait pas toujours brisée en même temps que le col et
même avant lui. D'un autre côté, cet amincissement rend compte de la facilité
avec laquelle le pus, dans les coxalgies, se fraye un passage dans le bassin
par perforation du fond de la cavité cotyloïde; et il explique enfin comment,
après la désarticulation du fémur, l'inflammation qui s'empare de la cavité
articulaire peut se transmettre par voisinage au périoste qui tapisse la paroi
correspondante du bassin, et donner lieu à un abcès intra-pelvien, ainsi que
j'en ai rapporté un cas à la Société de chirurgie.
La profondeur de la
cavité cotyloïde présente quelques différences selon les sujets; elle varie de
25 à 35 millimètres, et les diamètres de son orifice sont de cinq à six
centimètres en tous sens.
Quote p. 925
Le cartilage qui revêt
la tête est plus épais au centre qu'à la circonférence, contrairement à ce
qu'on observe à la cavité cotyloïde où il affecte une disposition inverse. Il
n'occupe pas toute la portion articulaire, il est interrompu, dans l'étendue de
10 millimètres environ, par l'insertion du ligament rond.
Cette insertion ne se fait point au centre de la tête, mais bien sur l'hémisphère postérieur et beaucoup plus en dedans qu'en dehors. Au fond de l'échancrure ou dépression que l'on observe en ce point sur le squelette, se voient plusieurs trous destinés au passage des vaisseaux que contient ce ligament et qui sont destinés à nourrir cette portion de l'os.
Quote pp. 927-929
Les moyens à l'aide
desquels les surfaces articulaires sont assemblées et maintenues sont une
capsule fibreuse tapissée par une synoviale, le ligament rond et des muscles
puissants et nombreux.
La capsule ou ligament
capsulaire, véritable ligament annulaire qui enveloppe les deux surfaces
articulaires, s'insère d'une part au pourtour de la cavité cotyloïde, sur le
bourrelet fibreux et les rugosités déjà signalées autour du sourcil
cotyloïdien, et d'autre part embrasse la base du col. Ses insertions au fémur
ont lieu en avant à une ligne rugueuse étendue du petit au grand trochanter, en
arrière sur le col même, à l'union de son tiers externe avec ses deux tiers
internes; elle offre donc une plus grande étendue en avant qu'en arrière. En
avant et en haut, ses insertions sont très solides et fortifiées par un gros
faisceau de fibres blanches formant réellement un ligament à part, épais de 2 à
3 millimètres, auquel Bertin avait donné le nom de ligament untérieur,
actuellement connu sous celui de ligament de Bertin. Les frères Weber le
désignent sous le nom de ligament supérieur et le regardent comme le ligament
le plus épais du corps humain, sans même en excepter le tendon d'Achille,
exagération qu'on s'explique difficilement. Il s'étend obliquement de la racine
de l'épine iliaque antérieure et inférieure à la base du petit trochanter,
confondant ses fibres profondes avec celles de la capsule, et paraît plus
spécialement destiné à limiter l'extension d'abord, puis la rotation et
l'abduction; lorsque la cuisse est tournée en dedans, il s'enroule autour du
col fémoral, et la rotation en dehors le ramène progressivement à la
disposition rectiligne.
Suivant Lisfranc, la
capsule fémorale offrirait, comme l'humérale, cette particularité d'être
conique, mais en sens inverse: c'est-à-dire que sa portion rétrécie serait
attachée au fémur au lieu de l'être au bassin. D'où cette première conclusion
que lors même que la capsule serait complétement déchirée à ses attaches
fémorales, la luxation ne pourrait se produire la tête étant retenue par son
collet; et cette autre que dans la désarticulation coxo-fémorale il importe,
pour pouvoir dégager la tête, de la diviser à la base même du sourcil
cotyloïdien. M. Malgaigne adopte cette manière de voir qui me paraît reposer
sur une interprétation fautive, au moins en ce qui concerne la deuxième
conclusion. Ce n'est point, en effet, la capsule qui retient alors la tête
fémorale dans la cavité, c'est la pression atmosphérique, si bien que quand on
veut arracher la tête du fémur, il faut d'abord donner accès à l'air, ce qui a
lieu dès que l'on a soulevé ou entamé le bourrelet fibreux cotyloïdien qui fait
l'office de soupape. Je reviendrai bientôt sur ce point intéressant. Le
ligament rond, ou interarticulaire, s'étend de la dépression signalée
précédemment sur la tête fémorale au bord de l'échancrure pubio-ischiatique, où
il se décompose en trois bandelettes formant une sorte de gaîne
infundibuliforme; c'est dans cette gaîne que s'engagent les vaisseaux
articulaires ainsi conduits jusque dans la tête du fémur. C'est donc plutôt un
moyen de protection pour les vaisseaux nourriciers de la tête fémorale qu'un
ligament; il est évident qu'une fois la capsule rompue, il est incapable de
s'opposer à la sortie de la tête. Quant au rôle que lui fait jouer Gerdy, de
faciliter la luxation en chassant la tête lorsqu'on porte le membre dans
l'adduction forcée, il me paraît, comme à M. Malgaigne, tout à fait
inacceptable. La synoviale qui tapisse l'articulation de la hanche est peu
compliquée dans sa marche; elle recouvre les cartilages de la cavité et de la
tête, puis passe au-devant du paquet graisseux qui occupe le fond du cotyle, lequel
reste ainsi en dehors de l'articulation et enfin enveloppe le ligament rond.
Sur les cartilages elle se réduit à son feuillet épithélial, mais reprend tous
ses caractères sur la capsule fibreuse. Il importe de noter qu'elle descend
bien moins bas sur le col que les attaches fibreuses extérieures du ligament
capsulaire, en sorte que telle fracture qui pourrait être de prime abord
regardée comme intra-articulaire, parce qu'elle est située au-dessus de la
ligne à laquelle s'attachent en dehors les fibres ligamenteuses, peut n'être
cependant en réalité qu'extra-articulaire.
Le paquet graisseux
sous-synovial du fond de la cavité cotyloïde mériterait à peine d'attirer
l'attention si on ne lui avait fait jouer un très grand rôle dans les
phénomènes d'allongement et de raccourcissement observés dans les coxalgies,
phénomènes sur lesquels on a tant écrit. Or c'est là, je le crains, une
question insoluble, malgré les travaux récents de M. Parise (1); et si dans
certaines coxalgies on trouve effectivement ce bourrelet cotyloïdien imbibé de
liquides et gonflé, ce qui permet de supposer que cette tuméfaction, jointe à
la présence d'une accumulation de liquide dans la cavité synoviale, peut
repousser la tête et par conséquent donner lieu à un allongement réel, il faut
convenir que cet allongement est de si peu d'importance, et les chances
d'erreur dans la mensuration si nombreuses, qu'il est impossible de faire
entrer sérieusement ce symptôme en ligne de compte pour le diagnostic. J'ai vu
des chirurgiens, qui avaient la prétention de juger cette question à coup sûr
et par des moyens infaillibles, trouver alternativement et sur le même sujet de
l'allongement et du raccourcissement.
(1) Archives de
médecine, 1842, no de mai. — Recherches historiques, physiologiques et pathologiques
sur le mécanisme des luxations spontanées du fémur; et juillet 1843. – Mémoire
sur l'allongement et le raccourcissement du membre inférieur dans la coxalgie.
Pour faire l'histoire
complète des moyens d'union des surfaces articulaires, il faudrait encore
parler des muscles qui peuvent à bon droit être classés parmi les plus
puissants. Mais, outre qu'il en a déjà été question dans l'exposition des
différents plans qui enveloppent l'articulation, et qu'y revenir serait
s'exposer à des répétitions, il faut encore remarquer que depuis la découverte
des anesthésiques à l'aide desquels on peut annuler leur action, leur étude au
point de vue de l'obstacle qu'ils peuvent apporter à la réduction des
luxations, n'offre plus d'importance.
Les vaisseaux et nerfs
de l'articulation coxo-fémorale sont tous fournis par les artères circonflexes
interne et externe et l'obturatrice; ils s'introduisent dans la cavité par
l'échancrure ischio-pubienne et se distribuent au paquet adipeux articulaire, à
la synoviale et à la tête du fémur par l'intermédiaire du ligament rond. Les
vaisseaux qui alimentent la capsule après avoir traversé ses fibres
d'implantation, pénètrent dans le col fémoral, disposition importante sur
laquelle je reviendrai en faisant l'histoire de la nutrition de l'extrémité
supérieure du fémur.
Physiologie de
l'articulation coxo-fémorale. Cette articulation qu'on a comparée à
l'assemblage connu en mécanique sous le nom de noix, en remplit effectivement
toutes les conditions; tous les mouvements y sont possibles, la flexion,
l'extension, l'abduction, l'adduction, la rotation, et enfin la circumduction.
Toutefois, la flexion est incomparablement plus étendue que l'extension limitée
par le ligament de Bertin; de même l'adduction est plus facile que l'abduction.
Or, il faut remarquer que c'est précisément dans le sens de l'adduction unie à
la flexion, c'està-dire des mouvements les plus étendus, que se produisent les
luxations les plus fréquentes, tandis qu'elles sont excessivement rares dans l'abduction,
et plus encore dans l'extension.
Si l'on eût dit, il y
a trente ans, à un physiologiste que le membre inférieur était suspendu au
tronc par la pression atmosphérique, il aurait certainement déclaré la chose
impossible; c'est là cependant un fait qui a pris rang parmi les vérités les
mieux établies.
La démonstration en
est assez simple: sur un cadavre dont les membres inférieurs sont pendants, on
coupe circulairement tous les muscles qui entourent la racine de la cuisse,
puis on incise avec précaution et circulairement la capsule y compris le
ligament de Bertin; le membre, quoique dépourvu de toutes ses attaches, soit
musculaires, soit ligamenteuses, continue à rester attaché au tronc, ce qui
prouve déjà que ce ne sont ni les muscles, ni la capsule qui retiennent dans
l'articulation la tête du fémur. Si on perfore alors avec une vrille le fond de
la cavité cotyloïde, à l'instant même où quelques bulles d'air s'insinuent dans
l'articulation, le membre se détache et tombe, suspendu seulement par le ligament
rond impuissant à le retenir dans la cavité articulaire. Cette expérience
démontre sans réplique que la pression atmosphérique suffit seule à soutenir le
poids du membre inférieur et à maintenir en contact parfait les surfaces
articulaires. Mais il est encore un autre moyen de prouver que telle est bien
la cause réelle de ce phénomène, c'est de boucher la perforation avec le doigt
et de replacer la tête dans la cavité cotyloïde : un claquement particulier se
fait entendre, et le phénomème du vide s'étant reproduit, le membre se trouve
de nouveau suspendu; puis, dès qu'on laisse l'air rentrer dans la cavité
articulaire, le fémur se détache.
Quote pp. 931-933
Les fractures du col
du fémur sont de toutes, peut-être, celles qui ont le plus de tendance à ne
point se consolider, et c'est à l'insuffisance de nutrition du fragment
supérieur qu'on a attribué cette particularité; il importe d'examiner si c'est
là effectivement la véritable cause. Lorsqu'on injecte les artères du membre
inférieur avec des substances pénétrantes comme le vernis ou l'essence de
térébenthine, on voit dans les cas heureux la surface du grand trochanter et
celle du col, jusqu'au niveau de l'insertion du cartilage, couvertes d'un
réseau artériel fin et délié. Dans l'articulation coxo-fémorale, pénètrent par
l'échancrure ischio-pubienne, des artérioles qui se portent les unes par
l'intermédiaire du ligament rond dans la tête du fémur, et les autres dans le
tissu cellulo-graisseux de la dépression cotyloïdienne. Tous ces vaisseaux sont
fournis par la circonflexe interne, branche de la fémorale profonde et par
l'obturatrice; quelquefois la circonflexe externe envoie quelques rameaux
périostiques sur le grand trochanter. Si l'on fend alors le fémur par le
milieu, y compris le grand trochanter, le col et la tête, on peut voir que tous
ces vais seaux, ceux qui pénètrent par le col et le grand trochanter, et ceux
qui arrivent par le ligament rond, forment, en s'anastomosant dans l'intérieur
du tissu osseux, un réseau très riche auquel viennent également aboutir les
ramuscules de l'artère nourricière du fémur. Sous le rapport de la richesse
vasculaire, la tête du fémur ne le cède donc en rien aux autres parties du
tissu osseux, ce que prouvent d'ailleurs sans réplique les phénomènes inflammatoires
dont elle est si souvent le siége.
Mais n'est-il pas à
craindre que dans les fractures qui siégent sur la partie du col la plus
rapprochée de la tête, et qui s'accompagnent d'une déchirure complète du
périoste, le fragment qui reste dans la cavité cotyloïde, ainsi privé de toute
communication avec les vaisseaux anastomotiques inférieurs et réduit à ceux que
lui fournit le ligament rond, ne soit plus nourri que d'une manière
insuffisante et devienne incapable sinon de vivre, du moins de subvenir aux
frais de la réparation? Telle est la question qu'il s'agit de résoudre.
Les vaisseaux qui
abordent le fragment cotyloïdien par le ligament rond, alors même qu'on les
suppose complétement isolés de ceux qui alimentent l'extrémité supérieure du
fémur, paraissent à priori bien suffisants à sa nutrition. Il suffit d'ailleurs
de considérer ce qui se passe dans d'autres parties du squelette, la diaphyse
des os longs par exemple, dont la vascularité est relativement moins développée
et qui cependant se consolide au moyen d'un cal parfaitement bien organisé,
pour comprendre qu'un pareil phénomène dans les fractures du col non-seulement
n'a rien d'invraisemblable mais est au contraire très naturel. Enfin on sait
que par le fait même de l'inflammation, conséquence inévitable des désordres
qui accompagnent toute solution de continuité, les vaisseaux, si petits qu'on
les suppose, loin de s'oblitérer subissent au contraire de notables
changements, que leur calibre augmente, qu'il s'en crée de nouveaux, et que
tous ces phénomènes, observés aussi bien dans les os que dans les autres
tissus, ont été également signalés dans la tête du fémur. Le raisonnement basé
sur les faits anatomiques et physiologiques tend done à prouver que dans les
fractures du col les fragments, le supérieur aussi bien que l'inférieur,
possèdent des éléments suffisants de consolidation.
Toutefois la
démonstration ne serait pas complète si les faits pathologiques ne venaient à
l'appui or ces derniers montrent que dans certaines conditions, qui sont il est
vrai difficiles à réaliser mais qui se rencontrent cependant quelquefois les
fractures du col, même intra-capsulaires, c'est-à-dire très rapprochées de la
tête, sont susceptibles d'une consolidation osseuse parfaite, et qui ne le cède
en rien à celle des autres os. Quelles sont donc ces conditions?
En première ligne, il
faut placer le rapport exact entre les fragments; puis viennent, mais tout à
fait sur un second plan, les causes générales qui retardent ou empêchent la
consolidation, à savoir l'âge du sujet, sa constitution, et les maladies
antérieures le cancer et les tubercules par exemple.
S'il était possible de maintenir les deux fragments dans un rapport exact, nul doute que les fractures du col ne se consolident en aussi peu de temps et d'une manière tout aussi complète que les fractures du corps de cet os; mais là est la difficulté, commune d'ailleurs à beaucoup de fractures intra-articulaires. Dans les fractures extra-articulaires, les lambeaux de périoste, les débris musculaires retien nent toujours plus ou moins les deux fragments attachés l'un à l'autre et les empêchent de se séparer complétement; dans les fractures intra-articulaires au contraire, toujours un des fragments, dépourvu de périoste ou de muscles, tend à s'éloigner de l'autre. Dans les solutions qui portent sur la portion intra-articulaire du col, le fragment cotyloïdien peut être complétement séparé du fémur, et comme alors il est retenu dans la cavité de l'os coxal, non par le ligament rond comme on l'a dit, mais par la pression atmosphérique, et que, d'autre part, le fragment inférieur, sollicité par les muscles, s'élève en même temps qu'il se porte dans la rotation en dehors, tout contact cesse et chaque fragment travaille isolément à sa réparation. On comprend l'influence que doit avoir sur la consolidation un pareil état de choses. Tous les efforts de l'art doivent donc tendre à rapprocher et maintenir les deux fragments, et alors même que l'on parvient à ramener l'inférieur au contact du supérieur, il faut encore savoir qu'on n'a satisfait qu'à une partie des indications, le fragment cotyloïdien fixé au bassin continuant à se mouvoir à chaque inflexion du tronc. C'est pour obvier à ce dernier inconvénient et immobiliser complétement les deux fragments que M. Bonnet a donné le conseil, auquel on ne saurait trop se conformer, de placer le malade dans un appareil qui emboîte non-seulement les deux membres inférieurs, mais encore le tronc jusqu'aux épaules. C'est effectivement la seule manière d'obtenir un contact, je ne dirai pas parfait, mais suffisant à une consolidation régulière et complète.
External links
Richet A. Traité pratique d' Anatomie
medico-chirurgicale. Paris: F. Chamerot, 1857. [books.google]
Authors & Affiliations
Didier Dominique Alfred Richet (1816-1891) was a French anatomist, prosector and surgeon, who served as professor of surgical pathology. [wikipedia.org]
,_chirurgien.jpg) |
| Alfred Richet (between 1860-1890) Author: Bacard Fils (Paul Bacard, dir.); original in the wikimedia.org collection (CC0 – Public Domain, color correction) |
Keywords
ligamentum capitis femoris, ligamentum teres, ligament of head of femur, anatomy, role, vascularization
NB! Fair practice / use: copied for the purposes of criticism, review, comment, research and private study in accordance with Copyright Laws of the US: 17 U.S.C. §107; Copyright Law of the EU: Dir. 2001/29/EC, art.5/3a,d; Copyright Law of the RU: ГК РФ ст.1274/1.1-2,7
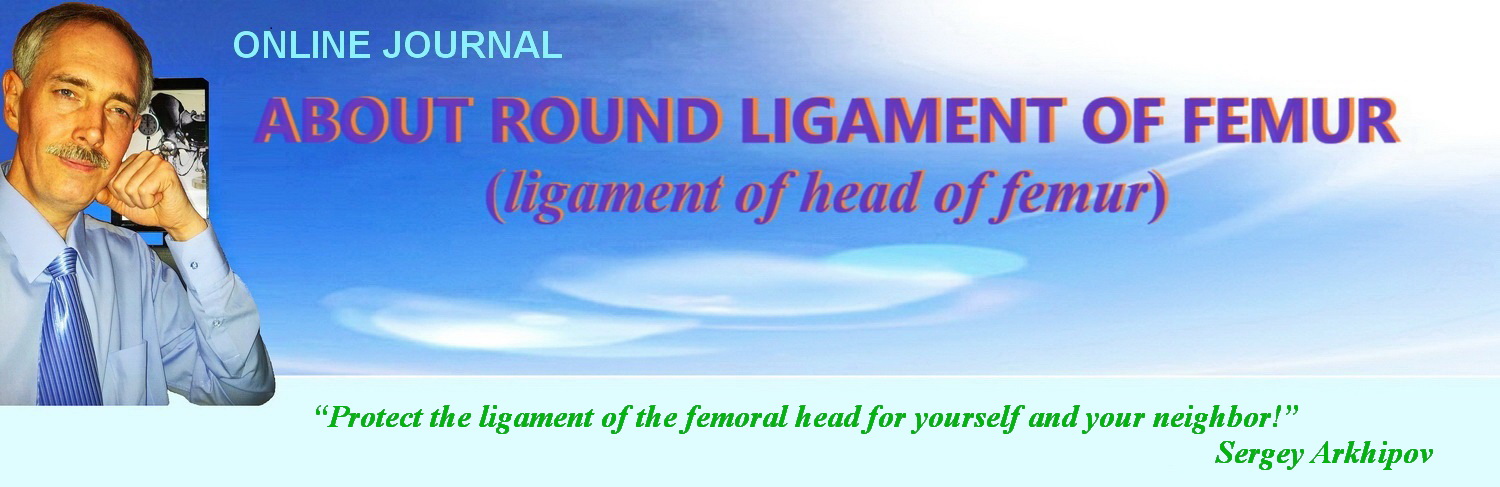

Comments
Post a Comment